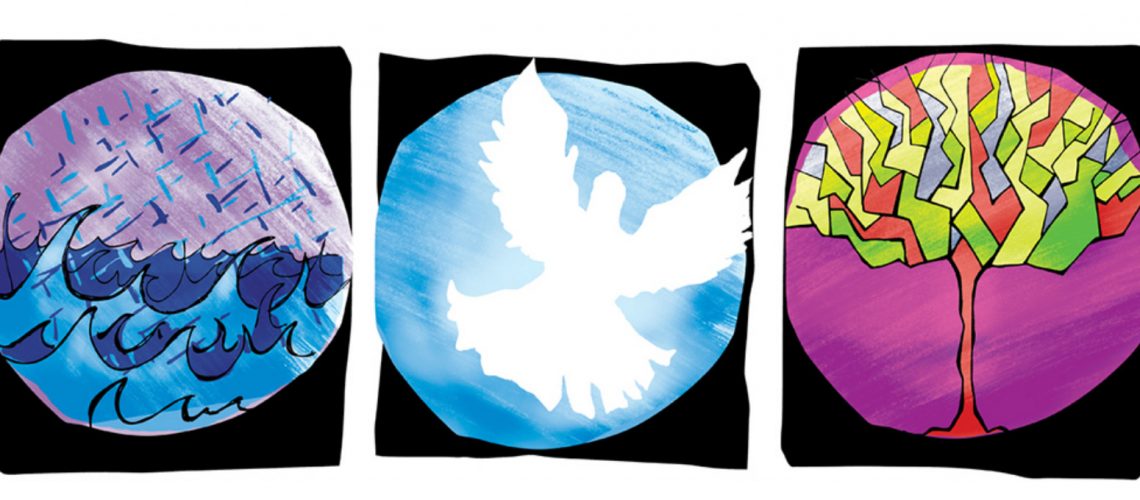A la fin de notre parachah, après l’épisode du déluge et celui de la tour de Babel, on assiste à un étrange phénomène qui n’est peut-être pas étranger au départ d’Abraham : la réduction drastique de la durée de vie des générations, au point même que certains enfants en viennent à mourir avant leurs parents ! C’est ce qui arrive à Arpakhchad, à Peleg et à Nahor (Genèse 11, 13, 19, 25). C’est aussi ce qui arrive à la génération d’Abraham : son père Terah, engendre trois fils, mais voici que l’un deux – Haran – s’en vient à mourir « devant son père » ou « avant son père », nous dit le texte (Genèse 11, 28). Comme si la génération ne parvenait plus à se faire, puisque les fils commencent à mourir avant leur père, réduisant à néant la possibilité de rebondir dans l’histoire et d’emmener celle-ci de l’avant. Serait-ce la fin de l’histoire et des générations qui la composent ? L’humanité traverse une crise de la génération : elle se reproduit encore, mais cette simple reproduction ne parvient plus à générer un avenir digne de ce nom, un temps qui dépasse la simple reproduction et ouvre ainsi les enfants à un temps qui se situe au-delà du temps des parents et relance l’histoire humaine vers des sentiers que les parents ne pouvaient même pas imaginer, vers un avenir qui échappe à la logique de l’origine et à son déterminisme morbide. Métaphoriquement, cela se vit lorsqu’une civilisation semble acculée à elle-même et à la logique qu’elle s’est elle-même construite, au point qu’elle ne trouve plus les forces vives pour se renouveler et rebondir au-delà du modèle qui prévaut. Les exigences sont devenues tellement contraignantes qu’elles semblent condamner chacun à une fuite en avant, à un temps où les enfants ne survivent pas à leurs parents, parce qu’ils sont happés par un modèle qui ne leur laisse plus de forces de vie autres, au-delà. Les enfants meurent alors à cause des dettes de leurs parents…
Abraham est précisément appelé à partir et à ouvrir un au-delà au moment où aucune génération ne semble plus possible : la vie se réduit à la simple reproduction d’un modèle imposé, reproduction qui se découvre elle-même mortelle dans l’enfant – c’est le temps mort, qui ne reconduisant que lui-même est inéluctablement mortel. Donc Abraham doit partir pour relancer la génération et en ce sens devenir bénédiction pour toute la terre : sortir du temps mort, qui est la fin des temps ou la mort du temps et de ceux qui y vivent, pour relancer le temps à travers la génération, c’est-à-dire par l’introduction d’un principe de renouvellement possible face au temps de l’origine. Tout n’est pas donné dans l’origine, il peut encore arriver quelque chose dans le temps qui constitue une surprise par rapport au passé, et qui soit donc capable de relancer la génération humaine par-delà la reproduction mortelle. Le départ d’Abraham s’inscrit dans cette rupture possible avec l’origine, puisqu’il doit quitter le lieu de sa naissance, la maison de son père, pour aller vers une terre qui n’est pas nommée, et donc pour s’engager dans un avenir tout à fait imprédictible, imprévisible, dans une aventure qui ne surgira pour lui que chemin faisant. C’est en se lançant sans savoir où l’on va mais parce qu’il faut y aller, que la vie s’invente à la vitesse des pas qui nous portent vers elle. Dans la tradition juive, on appelle cela la Halakhah, la marche en avant où nous nous découvrons en recherche d’une vie qui nous appelle, une vie dont nous inventons chaque jour, pas à pas, les modalités pratiques de réalisation en écoutant et en étudiant plus avant l’appel à partir duquel elle surgit.
Shabbat chalom